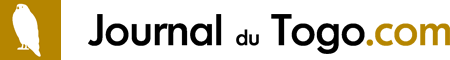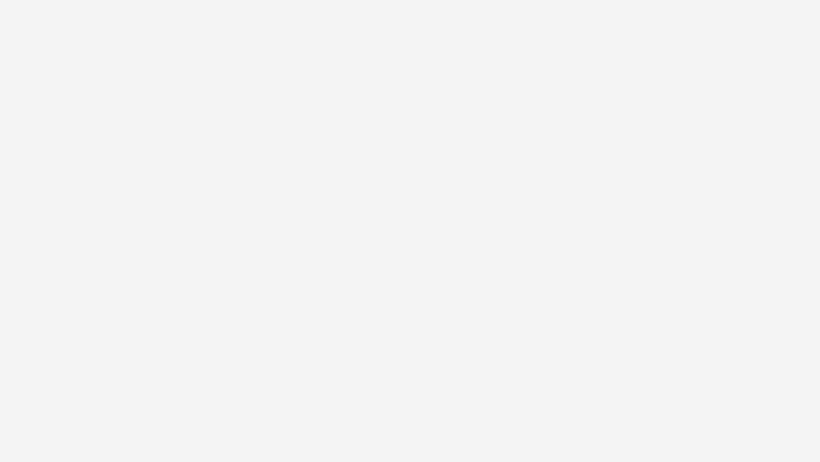Au Mexique, l’eau est une denrée rare. La saison des pluies n’y dure que de mai à septembre.
Les deux tiers de son territoire sont considérés comme arides ou semi-arides avec des précipitations annuelles inférieures à 500 mm. Dans le tiers sud, moins peuplé et plus humide, elles atteignent une moyenne de 2.000 mm.
Pourtant, dans ce pays de 120 millions d’habitants, grand comme quatre fois la France, obnubilé par ses problèmes économiques, le trafic de drogue, la violence, la pollution et les tremblements de terre, la quête de l’eau n’apparaît pas comme une priorité des dirigeants.
Dans ce contexte, l’AFP a mobilisé plusieurs de ses photographes et vidéastes pendant 24 heures afin de montrer comment des Mexicains vivent au quotidien ce manque d’eau.
Entretiens, photos et vidéos ont été réalisés au début de l’épidémie de Covid-19 au Mexique.
– « L’eau a le goût de la terre » –
A Juanacatlan, dans l’Etat de Jalisco, l’eau n’est pas potable. Elle arrive dans les maisons par des tuyaux tirés depuis le fleuve Santiago. Pour Rodrigo Saldaña, 65 ans, qui se bat pour une eau potable dans sa région, le gouvernement ne fait rien pour la rendre propre à la consommation.
« Boire de l’eau courante ? C’est risqué ici », confie Rodrigo à l’AFP.
« Il y a quelques années, un garçon du coin, nommé Miguel Lopez Rocha, est tombé dans le canal de l’Ahogado en essayant de récupérer son ballon. Il est mort empoisonné. Quiconque avale l’eau de cette rivière s’expose à la mort », prévient-il.
Virginia Lozano Romo, 51 ans, vit depuis neuf ans dans le quartier Esperanza de la localité de Tonala, également dans le Jalisco. Elle ne sait pas ce qu’est vivre avec de l’eau courante et n’a jamais bu d’eau minérale.
« Ici, l’eau a le goût de la terre », dit-elle.
« Ma fille et moi nous transportons de l’eau chaque jour du puits. Et nous savons qu’elle est contaminée, qu’elle rend les enfants malades », déplore-t-elle.
– La couleur d’un mauvais café –
Dans le même Etat coule la source de Mintzita, qui approvisionne la ville de Morelia. Une grande usine à papier fait vivre ses habitants. Ici, en raison des déchets qu’elle déverse dans le conduit qui relie la source à la ville, l’eau, constate le photographe, a une forte odeur et la couleur d’un mauvais café.
Mais, à Ciudad Juarez, Chihuaha, à quelques enjambées du mur de la frontière sud des Etats-Unis, l’eau a le goût du sel. Lorsqu’elle coule. Sinon, pour Fabiola, mère de deux jeunes enfants, c’est plus compliqué.
« Pour boire, nous avons deux bidons de 20 litres que le gouvernement nous fournit. Parfois, nous allons nous-mêmes chez le fournisseur. Cela nous coûte 22 pesos (environ 1 dollar). Parfois, un petit camion passe. Là, c’est 15 pesos (environ 70 cents) », explique-t-elle.
« Depuis que le gouvernement a installé l’eau ici, il y a 15 ans, le problème existe », observe la jeune femme. « Ils ont toujours su que cette eau ne pouvait pas être consommée et ils ne font rien ».
« Des fois, il faut des bidons pleins d’eau pour pouvoir laver la vaisselle, se baigner, on ne peut pas laver les vêtements car on en consomme beaucoup. Et j’ai essayé une fois de prendre un petit verre du robinet. C’est mauvais. Du sel pur. Imbuvable », dit-elle.
Selon elle, « lorsque l’eau sort, elle est noire, avec beaucoup de terre, une couleur de fer rouillé. Il faut attendre trois ou quatre heures avant de pouvoir commencer à l’utiliser ».
– Système D –
Parfois, il faut aussi recourir au système D. C’est le cas de Salomé Moreno, 47 ans, du quartier de Lazaro Cardenas à Tijuana, qui vit sans eau dans sa maison depuis 26 ans et ne sait pas pour quelle raison.
Elle montre au photographe de l’AFP le tuyau qu’elle a bricolé et qui part d’une habitation voisine de la sienne. « J’achète l’eau à un voisin. Lui en a. Cela me coûte très cher », déplore-t-elle.
María de la Luz Alonso, 53 ans, vit dans le même quartier. Elle a disposé des bassines d’eau sur une table pliante. « Je n’aime pas vivre comme ça, mais on s’adapte à tout, je suis ici depuis 3 ans. Moi aussi, j’ai mon tuyau qui vient de chez un voisin. C’est un tuyau long de 100 mètres ».
Mercedes Bocanegra, 54 ans, vit à San Juan Cadereyta, une ville de l’Etat de Nuevo Leon. Face au niveau de la rivière qui baisse, elle se lamente. « Il n’y a plus d’eau pour irriguer la terre. Il ne pleut plus. La sécheresse est terrible cette année ».