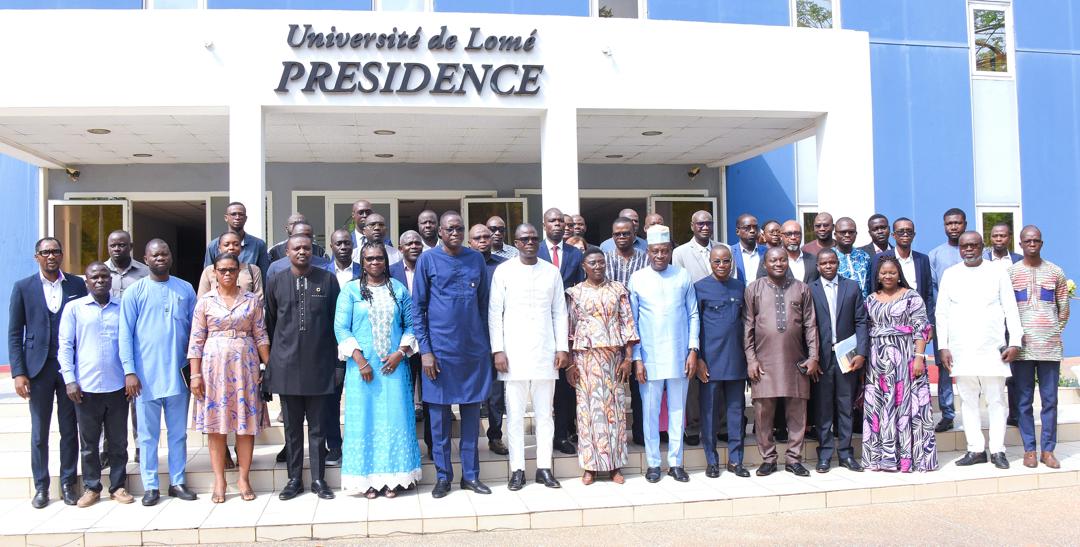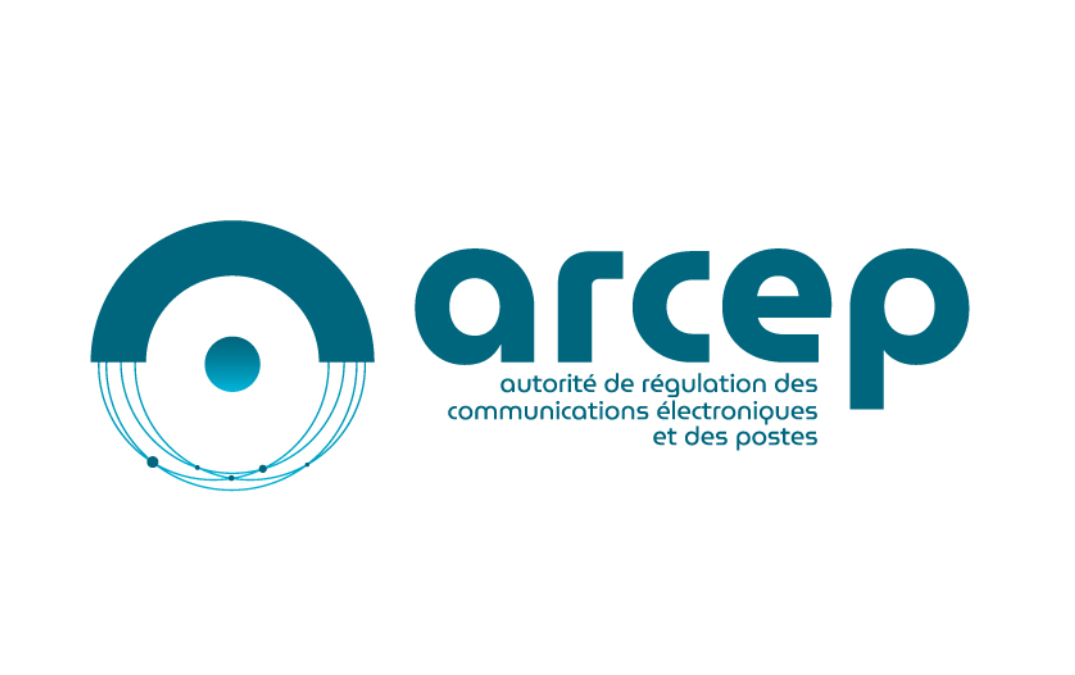En Côte d’Ivoire, le « miracle ivoirien » vacille sous le poids de la chute des cours mondiaux du cacao. Face à une crise qui menace l’équilibre social du premier producteur mondial, le président Alassane Ouattara a validé une profonde réforme du secteur. Entre refonte du calendrier agricole et concessions douloureuses aux multinationales, Abidjan tente de sauver les meubles au moment même où s’ouvre le Salon de l’Agriculture à Paris.
C’est un séisme dont l’épicentre se trouve à Abidjan, mais dont les répercussions se font sentir jusqu’à Lomé et Accra. En l’espace de quelques mois, l’or brun ivoirien a perdu de son éclat. Alors que la tonne s’échangeait à des sommets historiques l’été dernier, les cours sur le marché de Londres ont été divisés par trois, passant sous la barre symbolique des 3 000 dollars. Un retournement de situation qui place le pouvoir ivoirien au pied du mur.
Un prix d’achat devenu intenable
Le timing ne pouvait être plus délicat pour le chef de l’État. Réélu en octobre dernier sur la promesse d’un prix d’achat record de 2 800 F CFA le kilo, Alassane Ouattara doit aujourd’hui composer avec une réalité économique brutale. Ce tarif, fixé en pleine euphorie électorale, est devenu un fardeau financier pour les caisses de l’État.
Par conséquent, pour éviter un effondrement total du système de commercialisation, la présidence a dû donner son feu vert à une révision drastique des règles du jeu. Les autorités maintiennent pour l’instant le prix aux planteurs, mais elles le font au moyen de manœuvres structurelles d’envergure.
Le « sacrifice » du revenu décent
La mesure la plus spectaculaire, bien qu’officieusement actée, concerne le Différentiel de Revenu Décent (DRD). Cette prime de 400 dollars la tonne, arrachée de haute lutte par l’axe Abidjan-Accra en 2020 pour protéger les paysans, est désormais suspendue pour la prochaine campagne intermédiaire.
De fait, cette concession est un signal fort envoyé aux géants du négoce mondial tels que Cargill ou Barry Callebaut. Ces derniers, échaudés par la volatilité des marchés, freinaient leurs achats. En levant cette taxe, le Conseil Café-Cacao (CCC) espère relancer la signature des contrats à terme et garantir l’écoulement de la récolte, quitte à écorner l’un des piliers de sa politique sociale.
Une guerre contre la contrebande et un nouveau calendrier
Au-delà de l’aspect financier, Abidjan change de tactique sur le terrain. Un nouveau calendrier de commercialisation entre en vigueur :
- Ouverture de la campagne : avancée au 1ᵉʳ septembre (au lieu du 1ᵉʳ octobre).
- Fermeture : fixée au 1ᵉʳ mars (au lieu du 31 mars).
L’objectif est clair : verrouiller les frontières. Ainsi, en s’alignant sur les cycles réels de récolte et en devançant les manœuvres du Ghana voisin, la Côte d’Ivoire veut stopper l’hémorragie de fèves via la contrebande vers le Liberia ou la Guinée.
Entre Paris et Abidjan : une vitrine sous pression
Ironie du calendrier, ces annonces interviennent alors que la Côte d’Ivoire est l’invitée d’honneur du Salon international de l’Agriculture à Paris. Tandis que le ministre de l’Agriculture, Bruno Koné, vante les mérites du terroir ivoirien à la Porte de Versailles, les coulisses de la filière bruissent d’inquiétudes.
En définitive, malgré les mécanismes d’urgence activés par l’État et l’intervention de Transcao pour limiter la casse, l’inquiétude gagne les zones rurales. Car derrière les courbes boursières et les arbitrages budgétaires, ce sont des millions de planteurs qui retiennent leur souffle. Si les cours ne se redressent pas rapidement, la crise du cacao pourrait devenir bien plus qu’un choc économique : un test politique et social majeur pour le pouvoir d’Abidjan.