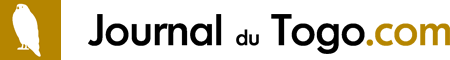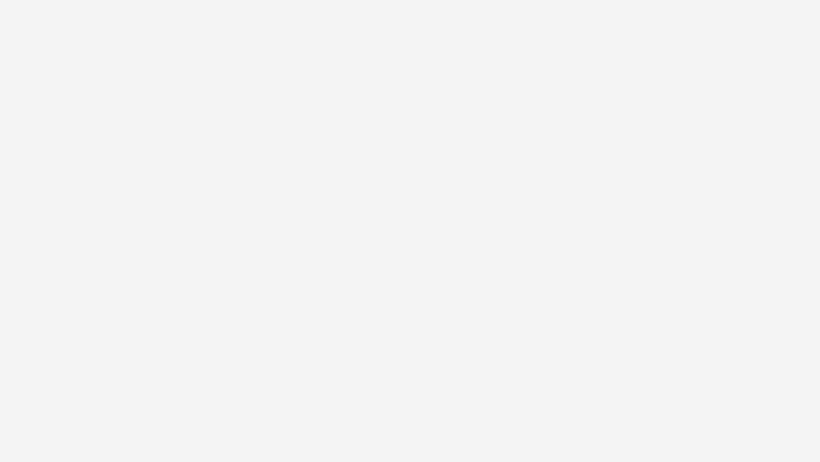Le discours sur l’émergence africaine serait-il la dernière trouvaille de dirigeants en perte de légitimité ? Certes, sur les 54 pays que compte le continent, une trentaine a enregistré des taux de croissance d’au moins 3 % en 2018. Les investissements directs étrangers y ont augmenté de 11 %, contre 4 % en Asie pendant qu’ils baissaient de 13 % au niveau mondial. Malgré ces chiffres, l’émergence de l’Afrique apparaît à bien des égards une arlésienne. C’est du moins l’avis de Kako Nubukpo qui a été ministre chargé de la Prospective et de l’Evaluation des politiques publiques du Togo (2013-2015) et chef du pôle « analyse économique et de recherche » de la Commission de l’Union économique et monétaire ouest-africaine à Ouagadougou. Dans une interview qu’il a accordée à nos confrères de Libération.fr, l’intellectuel togolais tire la sonnette d’alarme sur la réalité d’une Afrique qu’il juge à la dérive, subissant des prédations de toutes sortes, des sorties de capitaux licites et illicites… Il appelle à la mobilisation autour des projets de société collectifs et inclusifs, et à la reconquête des instruments de la souveraineté agricole.
Vous soutenez la thèse selon laquelle l’Afrique est toujours «le laboratoire du néolibéralisme», n’est-ce pas un peu exagéré ?
On pourrait ajouter l’Amérique latine. La spécificité de l’Afrique, c’est de coupler ce statut de laboratoire avec une démographie très dynamique et une absence de classe moyenne. L’Afrique a un terreau fragile qui accentue ses difficultés. La proximité des côtes libyennes avec celles de l’Europe rend encore plus urgente la nécessité de regarder ce qui se passe en Afrique.
C’est un continent cobaye, un laboratoire de postulats qui ne se vérifient pas, d’idéologies économiques en provenance du reste du monde… Erigée en horizon indépassable de la science économique, la pensée néolibérale n’a eu de cesse de tester sa toute-puissance en Afrique. On peut reprendre les propos de la philosophe Hannah Arendt lorsqu’elle affirmait que «l’Occident a pour habitude d’infliger aux populations périphériques les maux qu’il s’apprête à s’infliger à lui-même».
Mais en quoi l’Afrique est-elle un «laboratoire» ?
Historiquement, les dirigeants africains ont été formés pour être le relais du colonisateur, voire de le remplacer. La première école, créée par Louis Faidherbe en 1855 au Sénégal, s’appelait «l’Ecole des otages». L’expression était tellement forte qu’on l’a ensuite remplacée par «l’Ecole des fils de chefs». Il fallait qu’ils deviennent les relais de l’administration coloniale et qu’ils puissent à terme remplacer le colonisateur. Il y avait donc une extraversion originelle par rapport à l’élite.
Pendant toute cette période, les syndicats africains ont gagné en puissance. Et ce sont souvent leurs chefs de file qui ont pris le pouvoir. Or les qualités pour prendre le pouvoir ne sont pas forcément celles qu’il faut pour gérer l’après. Ensuite, les responsables politiques africains ont été pris en étau dans la guerre froide. Ce qu’il y a de commun dans ces deux expériences, africaine et sud-américaine, c’est que vingt ans après les indépendances, nous nous sommes retrouvés dans une grave crise de la dette.
Est-ce pour cette raison que vous affirmez que la tragédie grecque fut d’abord africaine ?
Oui. A partir des années 80, le FMI et la Banque mondiale utilisent l’Afrique pour tester le consensus de Washington, faisant de ce continent leur laboratoire où seront appliqués, contre une aide financière, des programmes d’ajustement structurel. Il s’agissait de faire de la désinflation compétitive, en clair faire baisser tous les coûts y compris ceux des salaires pour s’insérer dans la globalisation économique, le tout avec des réformes dites «structurelles» au premier rang desquelles il convient de mentionner la libéralisation du marché du travail et les privatisations des entreprises publiques.
Bref, ces plans ont conduit les Etats à réduire drastiquement leurs dépenses sociales, leurs investissements en infrastructures et la taille des fonctions et services publics. Au lieu d’assumer que ces jeunes nations avaient besoin de dépenser beaucoup pour construire les bases du développement, les bailleurs de fonds, comme le FMI, se sont arc-boutés sur la réalisation d’équilibres macroéconomiques de court terme. Les résultats se passent de commentaires : des sociétés africaines exsangues, des économies faiblement productives dépendantes du reste du monde, un chômage de masse dont le pendant est une vague sans précédent de migrations de populations jeunes.
Le FMI et la Banque mondiale ont agi comme si les conditions institutionnelles nécessaires à la réalisation des réformes étaient réunies. Or toutes les études démontrent le contraire, et on voit que le remède est pire que le mal. Les apôtres des politiques d’ajustement structurel expliquent, en cas de résultats insuffisants, que leurs réformes n’ont pas été totalement mises en œuvre et que si leur théorie ne cadre pas avec la réalité, cette dernière a forcément tort.
A vous écouter on est loin des discours de ceux qui expliquent que l’Afrique est désormais émergente.
Ce sont là des discours de tables rondes de bailleurs de fonds et autres cabinets de conseil. Derrière ces discours performatifs, les faits sont têtus : l’Afrique subsaharienne est la seule région du monde où la population extrêmement pauvre, vivant avec moins de 1,25 dollar par jour, a doublé en cinquante ans. C’est aussi la région du monde où la croissance du revenu par habitant est la plus faible depuis 1960. Ses Etats pointent depuis vingt ans dans le bas du classement de l’Indice de développement humain (IDH).
Alors rien n’encourage à l’optimisme ?
Pas sur cette question de l’émergence… D’ailleurs, la plupart des dirigeants africains ont des discours à géométrie variable. Au FMI, ils réaffirment de se conformer au néolibéralisme, à l’équilibre des finances publiques coûte que coûte ; à l’OMC à l’ouverture des frontières commerciales ; et dans les sommets avec les pays émergents, les voilà qui deviennent très volontaristes, vantant les mérites du néomercantilisme asiatique qui combine protection face aux importations et politiques agressives à l’export. Et quand ils se retrouvent à New York, au siège de l’ONU, ils n’ont plus qu’un seul credo : atteindre les objectifs du développement durable.
N’importe qui peut comprendre que tous ces discours forment un amas de contradictions. Et je ne parle pas ici de ces gouvernements qui souffrent de statistiques peu fiables. On ne dira jamais assez que dans la plupart des pays africains, pour avoir des données nationales fiables, on extrapole les statistiques urbaines à l’ensemble du pays. De telles pratiques ne peuvent pas rendre compte de la forte hétérogénéité des situations régionales pour un même pays.
L’Afrique rurale représente les deux tiers de la population africaine, et vous dites que c’est surtout elle qui souffre de la pauvreté. Comment la connecter au reste du monde ?
Elle est, en effet, déconnectée du monde. Nous savons bien que c’est grâce au travail des paysans, qui nous procurent des devises via les exportations, que les urbains peuvent jouir d’un niveau de vie beaucoup plus haut. Or l’agriculture africaine est prise en étau entre les prédations massives de terres auxquelles se livrent des pays émergents, comme la Chine, et l’importation récurrente de surplus agricoles étrangers au continent, qui baissent drastiquement les incitations pour les Africains à produire eux-mêmes ce qu’ils consomment. L’urgence africaine est celle de la voie de la reconquête des instruments de la souveraineté agricole.
Comment faire ?
Il s’agit d’opérer une transformation agricole en augmentant la productivité du secteur. Il s’agit aussi de faire en sorte de développer l’accès aux services de banques, d’assurances, de transports… Il faut surtout la mise en place de politiques agricoles dignes de ce nom. Il faut donc clarifier le rôle exact des pouvoirs publics dans la gestion, la régulation et le soutien aux prix et donc aux revenus des agriculteurs. Il faut aussi des institutions capables de cibler des aides. C’est ainsi qu’on pourra renforcer des chaînes de valeur agricoles. Il faut changer ce modèle de croissance extravertie qui conduit l’Afrique à exporter des produits sans les transformer et à importer en retour des produits finis et l’alimentation. C’est là le gage à terme d’une prospérité partagée et d’une réduction de l’immigration subie.
Vous dites d’ailleurs que certaines perspectives d’immigration sont gratuites et non fondées.
Migrants économiques, climatiques, réfugiés de guerre, ruées vers l’Europe… L’invasion semble aux portes de l’Europe. Sauf que les chiffres sont inexacts. Certains spécialistes de la question démographique, comme François Héran et Pierre Jacquemot que je cite dans mon ouvrage, contestent trois affirmations récurrentes sur le phénomène migratoire.
L’Europe du Nord ne sera pas peuplée de 25 % d’immigrés subsahariens, même si l’Afrique subsaharienne passe de 970 millions à 2,2 milliards de personnes en 2050. La pauvreté serait source de migration : cette affirmation est elle aussi fausse car on sait qu’en raison même de sa pauvreté, l’Afrique subsaharienne émigre peu. Plus un pays est pauvre, moins ses habitants ont de chances de migrer loin. L’aide au développement permettra de réduire les migrations : cette dernière affirmation est également fausse car plus un pays se développe, plus ses ressortissants ont les moyens financiers pour migrer…
Comment éviter de reproduire les erreurs du passé ?
Il faut cesser de croire que ce qui permet à un pays de s’en sortir, ce sont les matières premières. Je crois que la clé du développement réside dans la capacité à mobiliser les populations autour d’un projet objectif collectif. Mais pour que la population accepte de faire des sacrifices pour que demain soit meilleur qu’aujourd’hui, il faut des gouvernements crédibles et légitimes.
Encore faudrait-il que le temps court du politique corresponde à celui qu’exigent les enjeux du développement. De ce point de vue, je suis relativement pessimiste. D’autant que l’Afrique ne produit pas encore elle-même ses dirigeants.
Mais affirmer, comme vous l’écrivez, que «l’Afrique montre au reste du monde les dirigeants que le reste du monde veut voir», là encore, ça paraît exagéré.
Mais il est évident que la plupart des dirigeants ont le discours de la doxa internationale. L’essentiel de la classe politique africaine est offshore, elle est adoubée de l’extérieur, elle ne rend compte qu’à ses maîtres occidentaux. Certes, l’industrialisation, dont tout le monde parle, peut constituer une voie nécessaire à l’émergence. Mais elle ne saurait se substituer à l’impératif de définir un projet de société inclusif, ouvert. Une société qui tournerait résolument le dos à la prédation ayant cours dans des économies qui sont le plus souvent des économies rentières. Mais pour cela, il nous faut des dirigeants qui ont le sens de l’intérêt général.
Source: Libération.fr